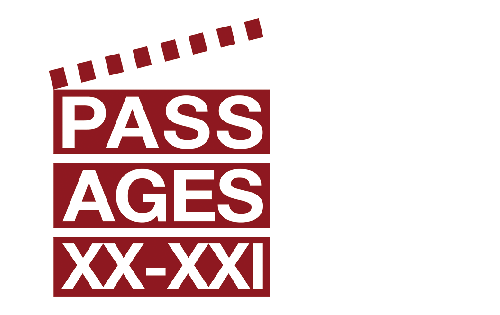Publié le 17 novembre 2025
–
Mis à jour le 17 novembre 2025
le 11 décembre 2025
Campus Berges du Rhône
De 14h à 16h
Le laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI) accueille pour l'année 2025-2026 le séminaire en études cinématographiques Anatomie de la recherche.
Ce séminaire en études cinématographiques est consacré à l'analyse, la théorie et l'histoire des images et du cinéma. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux objets émergents ainsi qu’aux questions de méthodologie de la recherche liées à l’apparition de nouvelles orientations disciplinaires. Il accueillera les travaux des doctorant·es, docteur·es et enseignant·es-chercheurs·euses qui font l’actualité de la recherche.
Ce séminaire mensuel se tiendra sur le campus Berges du Rhône un jeudi par mois, de 14h à 16h.
Intervention de : Occitane Lacurie (doctorante, Université Paris 1)
Titre de la thèse : « Voir les fantômes. Supercherie, mémoire, dispositif »
Le paradoxe est connu : les fantômes persistent au cœur d’époques dans lesquelles fleurissent les sciences nouvelles, les inventions de pointe, où la marche du progrès technique et social semble inarrêtable. La fascination pour les spectres dans la période révolutionnaire française (1), la vogue spirite au cœur des révolutions industrielles ouest-européennes ou japonaise (2), les spéculations surnaturelles qui innervent l’imaginaire technologique tout au long du XXe siècle (3)… Autant de manifestations fantomatiques qui ne se contentent pas d’exister au revers des révolutions scientifiques ou dans un souterrain de l’époque, mais qui s’immiscent directement dans les inventions nouvelles, voire qui en émanent. Un paradoxe, donc, exploré en 2000 par Jeffrey Sconce dans un livre fondateur Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television (4) qui montre la nature fondamentalement iconique de la présence spectrale qui se manifeste à travers les médias audiovisuels. Autrement dit, les machines reconfigurent un problème ancien de l’histoire de l’art et de l’anthropologie des images : la figuration des mort·es et leur action dans le monde des vivant·es.
Aussi cette thèse envisage-t-elle la dimension matérielle des manifestations spectrales en se focalisant sur trois moments de l’histoire des sciences et du cinéma qui voient l’émergence de techniques nouvelles, et dont la traduction filmique se charge de les peupler de fantômes. Ces trois moments – qui donnent à ce travail son sous-titre et sa structure – définissent chacun un corpus et une question. L’ingénierie et ses mutations à la fin du XXe siècle dans l’Est asiatique sous l’effet du processus de mondialisation du capitalisme, peut être mise en regard de films qui s’interrogent sur le chemin parcouru par les inventions spirites depuis l’autre fin-de-siècle, dans la première Révolution Industrielle. La cybernétique, au mitan du XXe siècle étatsunien et français, renouvelle le dualisme entre la chair et l’esprit chez les inventeurs de cerveaux artificiels, façonnant profondément les interfaces informatiques et leur potentiel médiumnique. La forensique, enfin, néologisme rassemblant différentes disciplines des sciences légales, informe les pratiques l’enquête par l’image dans le cinéma documentaire et expérimental de found footage. Autrement dit, ces sciences productrices d’images opèrent la même transaction que « les images des antiques cultes funéraires matérialisaient, par la pierre, l’argile, dans un medium artificiel supplantant les corps décomposés des morts (5) ».
-----
(1) Voir par exemple Emmanuelle SEMPÈRE, L’Épreuve du fantôme dans la littérature des Lumières, Paris, Classiques Garnier, coll. « L’Europe des Lumières », n˚ 87, 2023.
(2) Voir par exemple Mireille BERTON, Le medium (au) cinéma, Genève, Georg éditeur, coll. « Emprise de vue », 2021.
(3) Voir par exemple Fleur HOPKINS-LOFÉRON, Voir l’invisible: histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique (1909-1930), Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « Collection “Détours” », 2023.
(4) Jeffrey SCONCE, Haunted media: electronic presence from telegraphy to television, Durham (N.C.) London, Duke University Press, coll. « Console-ing passions », 2000.
(5) H. BELTING, An Anthropology of Images..., op. cit.
Occitane Lacurie est doctorante à l’École des Arts de la Sorbonne, critique, programmatrice et vidéaste. Ses recherches en culture visuelle et archéologie des médias, comme sa pratique vidéo proposent une approche matérialiste des images, des fantômes et des corps. Ses essais vidéographiques ont été montrés dans plusieurs festivals (Go Short, Pesaro, Marienbad, Lausanne Underground Film Festival, Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris…) et musées (Museum of Moving Image of New York, Jeu de Paume…). En tant que critique, elle fait partie du comité de rédaction de la revue Débordements et collabore au pôle culture et idées de Mediapart.
Ce séminaire en études cinématographiques est consacré à l'analyse, la théorie et l'histoire des images et du cinéma. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux objets émergents ainsi qu’aux questions de méthodologie de la recherche liées à l’apparition de nouvelles orientations disciplinaires. Il accueillera les travaux des doctorant·es, docteur·es et enseignant·es-chercheurs·euses qui font l’actualité de la recherche.
Ce séminaire mensuel se tiendra sur le campus Berges du Rhône un jeudi par mois, de 14h à 16h.
Intervention de : Occitane Lacurie (doctorante, Université Paris 1)
Titre de la thèse : « Voir les fantômes. Supercherie, mémoire, dispositif »
Le paradoxe est connu : les fantômes persistent au cœur d’époques dans lesquelles fleurissent les sciences nouvelles, les inventions de pointe, où la marche du progrès technique et social semble inarrêtable. La fascination pour les spectres dans la période révolutionnaire française (1), la vogue spirite au cœur des révolutions industrielles ouest-européennes ou japonaise (2), les spéculations surnaturelles qui innervent l’imaginaire technologique tout au long du XXe siècle (3)… Autant de manifestations fantomatiques qui ne se contentent pas d’exister au revers des révolutions scientifiques ou dans un souterrain de l’époque, mais qui s’immiscent directement dans les inventions nouvelles, voire qui en émanent. Un paradoxe, donc, exploré en 2000 par Jeffrey Sconce dans un livre fondateur Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television (4) qui montre la nature fondamentalement iconique de la présence spectrale qui se manifeste à travers les médias audiovisuels. Autrement dit, les machines reconfigurent un problème ancien de l’histoire de l’art et de l’anthropologie des images : la figuration des mort·es et leur action dans le monde des vivant·es.
Aussi cette thèse envisage-t-elle la dimension matérielle des manifestations spectrales en se focalisant sur trois moments de l’histoire des sciences et du cinéma qui voient l’émergence de techniques nouvelles, et dont la traduction filmique se charge de les peupler de fantômes. Ces trois moments – qui donnent à ce travail son sous-titre et sa structure – définissent chacun un corpus et une question. L’ingénierie et ses mutations à la fin du XXe siècle dans l’Est asiatique sous l’effet du processus de mondialisation du capitalisme, peut être mise en regard de films qui s’interrogent sur le chemin parcouru par les inventions spirites depuis l’autre fin-de-siècle, dans la première Révolution Industrielle. La cybernétique, au mitan du XXe siècle étatsunien et français, renouvelle le dualisme entre la chair et l’esprit chez les inventeurs de cerveaux artificiels, façonnant profondément les interfaces informatiques et leur potentiel médiumnique. La forensique, enfin, néologisme rassemblant différentes disciplines des sciences légales, informe les pratiques l’enquête par l’image dans le cinéma documentaire et expérimental de found footage. Autrement dit, ces sciences productrices d’images opèrent la même transaction que « les images des antiques cultes funéraires matérialisaient, par la pierre, l’argile, dans un medium artificiel supplantant les corps décomposés des morts (5) ».
-----
(1) Voir par exemple Emmanuelle SEMPÈRE, L’Épreuve du fantôme dans la littérature des Lumières, Paris, Classiques Garnier, coll. « L’Europe des Lumières », n˚ 87, 2023.
(2) Voir par exemple Mireille BERTON, Le medium (au) cinéma, Genève, Georg éditeur, coll. « Emprise de vue », 2021.
(3) Voir par exemple Fleur HOPKINS-LOFÉRON, Voir l’invisible: histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique (1909-1930), Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « Collection “Détours” », 2023.
(4) Jeffrey SCONCE, Haunted media: electronic presence from telegraphy to television, Durham (N.C.) London, Duke University Press, coll. « Console-ing passions », 2000.
(5) H. BELTING, An Anthropology of Images..., op. cit.
Occitane Lacurie est doctorante à l’École des Arts de la Sorbonne, critique, programmatrice et vidéaste. Ses recherches en culture visuelle et archéologie des médias, comme sa pratique vidéo proposent une approche matérialiste des images, des fantômes et des corps. Ses essais vidéographiques ont été montrés dans plusieurs festivals (Go Short, Pesaro, Marienbad, Lausanne Underground Film Festival, Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris…) et musées (Museum of Moving Image of New York, Jeu de Paume…). En tant que critique, elle fait partie du comité de rédaction de la revue Débordements et collabore au pôle culture et idées de Mediapart.
Informations pratiques
Lieu(x)
Campus Berges du Rhône
Salle CLI. -114, bâtiment CLIO
18, quai Claude Bernard
69007 Lyon
18, quai Claude Bernard
69007 Lyon