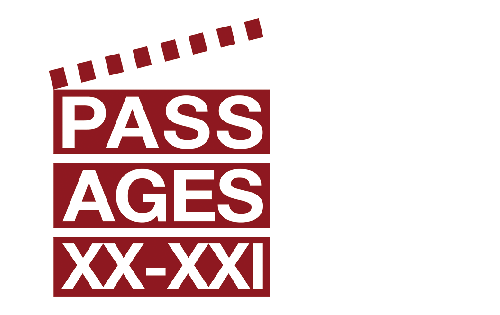Publié le 22 septembre 2025
–
Mis à jour le 6 octobre 2025
le 14 novembre 2025
Campus Berges du Rhône
De 14h à 16h
Séminaires du groupe de recherche Matérialités poétiques
Contacts : benoit.auclerc@univ-lyon3.fr; laure.michel1@univ-lyon2.fr; pascale.roux@univ-lyon2.fr
Le groupe de recherche Matérialités poétiques, qui rassemble des chercheure-euses de différentes disciplines dans le domaine de la poésie propose trois types de séances :
- Les séances communes au groupe de recherche. Elles seront organisées cette année autour d’une résidence de recherche-création de Milène Tournier (projet ÉcrIA : https://www.univ-lyon2.fr/recherche/quelques-projets-de-valorisation/ecria-ecriture-et-ia-en-contexte-artistique).
- Les séances Littérature. Elles se proposent d’explorer, de manière pluridisciplinaire, toutes les zones d'échange de la poésie avec les autres arts, dans la perspective d'une conception extensive de la poésie.
- Les séances Texte et langue (langue française et stylistique). Portant sur des questions variées, elles auront en commun de décloisonner les corpus (textes écrits en français, traduits en français, produits dans des aires dites « francophones ») et de poser la question l’interdisciplinarité que peut impliquer une telle démarche.
Littérature
« 'Résurgence du dictaphone' : poésies en performance et enregistrement (Sandra Moussempès, Charles Pennequin) ». Conférence de Gaëlle Théval, maîtresse de conférences en littératures et arts 20e-21e (Université de Rouen)
Si la poésie sonore naît, à la fin des années 1950, des possibilités offertes par le magnétophone et les techniques d’enregistrement, ces dernières n’ont cessé de hanter la poésie, depuis le début du siècle, de par leurs possibilités inouïes de conservation et de traitement du son et de la voix. Moyens incontournables de constitution de l’archive sonore, mais aussi outils de création, les techniques d’enregistrement ont été expérimentées, mais aussi poétiquement travaillées, thématisées, et performées, au point de devenir, semble-t-il, un paradigme poétique.
C’est ce paradigme, et la manière dont écriture poétique et performance s’y articulent, que nous nous proposons d’explorer dans les œuvres de Sandra Moussempès et de Charles Pennequin.
Loin d’être un simple instrument, l’enregistrement entre en effet, chez ces deux poètes, en résonance profonde avec une poétique et plus largement une vision du sujet dans son rapport à l’écriture, à la mémoire et à ses fantômes. Bien que tirant, à première vue, dans les sens opposés du « gros bruit » de l’intime (Pennequin) et du chant éthéré bouclant des voix fantômes vers une « lucidité de flottaison » (Moussempès), ces poétiques travaillent toutes deux à reconsidérer une écriture du moi et un lyrisme se jouant, dans l’écriture comme dans la performance, dans une relation appareillée et polyphonique de l’intime à l’extime. L’appareillage spécifique du dictaphone, partagé par les deux poètes, nous servira de point de départ pour explorer les résonances de cette matérialité poétique.
Partenaires :
Alliance Campus Rhodanien
Laboratoire HiSoMa – Histoire et sources des mondes antiques
Magnifique Printemps
Ministère de la Culture
Service Culturel de l’Université Lyon 3
Université de Lausanne
Université Grenoble Alpes
Contacts : benoit.auclerc@univ-lyon3.fr; laure.michel1@univ-lyon2.fr; pascale.roux@univ-lyon2.fr
Le groupe de recherche Matérialités poétiques, qui rassemble des chercheure-euses de différentes disciplines dans le domaine de la poésie propose trois types de séances :
- Les séances communes au groupe de recherche. Elles seront organisées cette année autour d’une résidence de recherche-création de Milène Tournier (projet ÉcrIA : https://www.univ-lyon2.fr/recherche/quelques-projets-de-valorisation/ecria-ecriture-et-ia-en-contexte-artistique).
- Les séances Littérature. Elles se proposent d’explorer, de manière pluridisciplinaire, toutes les zones d'échange de la poésie avec les autres arts, dans la perspective d'une conception extensive de la poésie.
- Les séances Texte et langue (langue française et stylistique). Portant sur des questions variées, elles auront en commun de décloisonner les corpus (textes écrits en français, traduits en français, produits dans des aires dites « francophones ») et de poser la question l’interdisciplinarité que peut impliquer une telle démarche.
Littérature
« 'Résurgence du dictaphone' : poésies en performance et enregistrement (Sandra Moussempès, Charles Pennequin) ». Conférence de Gaëlle Théval, maîtresse de conférences en littératures et arts 20e-21e (Université de Rouen)
Si la poésie sonore naît, à la fin des années 1950, des possibilités offertes par le magnétophone et les techniques d’enregistrement, ces dernières n’ont cessé de hanter la poésie, depuis le début du siècle, de par leurs possibilités inouïes de conservation et de traitement du son et de la voix. Moyens incontournables de constitution de l’archive sonore, mais aussi outils de création, les techniques d’enregistrement ont été expérimentées, mais aussi poétiquement travaillées, thématisées, et performées, au point de devenir, semble-t-il, un paradigme poétique.
C’est ce paradigme, et la manière dont écriture poétique et performance s’y articulent, que nous nous proposons d’explorer dans les œuvres de Sandra Moussempès et de Charles Pennequin.
Loin d’être un simple instrument, l’enregistrement entre en effet, chez ces deux poètes, en résonance profonde avec une poétique et plus largement une vision du sujet dans son rapport à l’écriture, à la mémoire et à ses fantômes. Bien que tirant, à première vue, dans les sens opposés du « gros bruit » de l’intime (Pennequin) et du chant éthéré bouclant des voix fantômes vers une « lucidité de flottaison » (Moussempès), ces poétiques travaillent toutes deux à reconsidérer une écriture du moi et un lyrisme se jouant, dans l’écriture comme dans la performance, dans une relation appareillée et polyphonique de l’intime à l’extime. L’appareillage spécifique du dictaphone, partagé par les deux poètes, nous servira de point de départ pour explorer les résonances de cette matérialité poétique.
Partenaires :
Alliance Campus Rhodanien
Laboratoire HiSoMa – Histoire et sources des mondes antiques
Magnifique Printemps
Ministère de la Culture
Service Culturel de l’Université Lyon 3
Université de Lausanne
Université Grenoble Alpes
Informations pratiques
Lieu(x)
Campus Berges du Rhône
Salle DEM.209
4 bis rue de l’Université
69007 Lyon
4 bis rue de l’Université
69007 Lyon